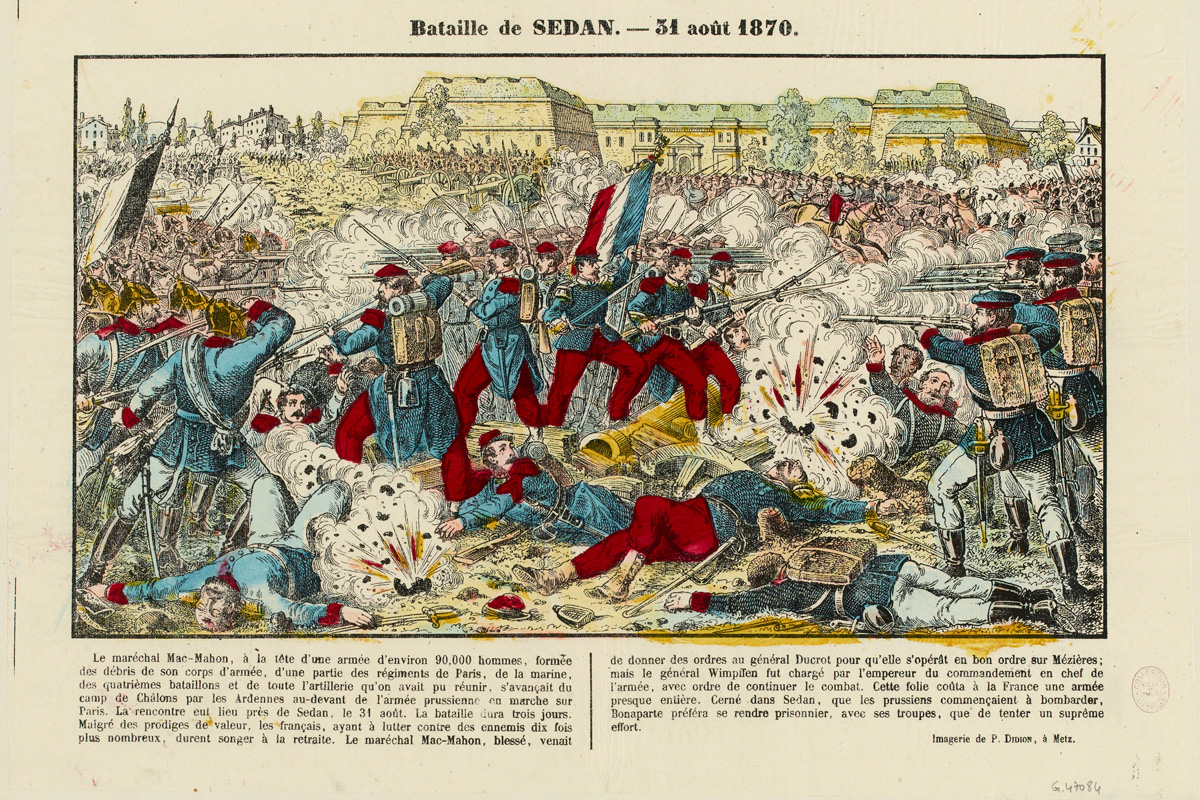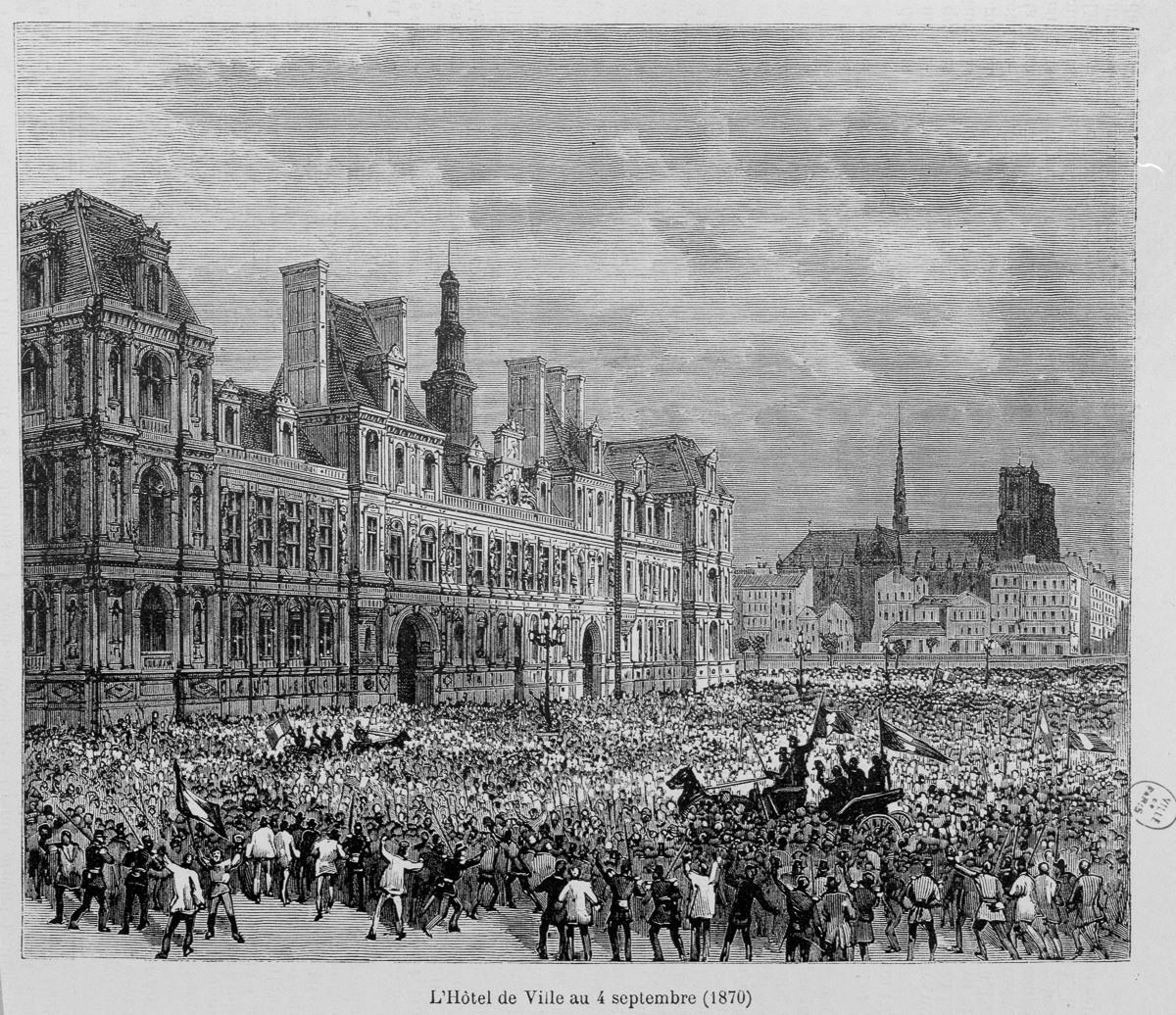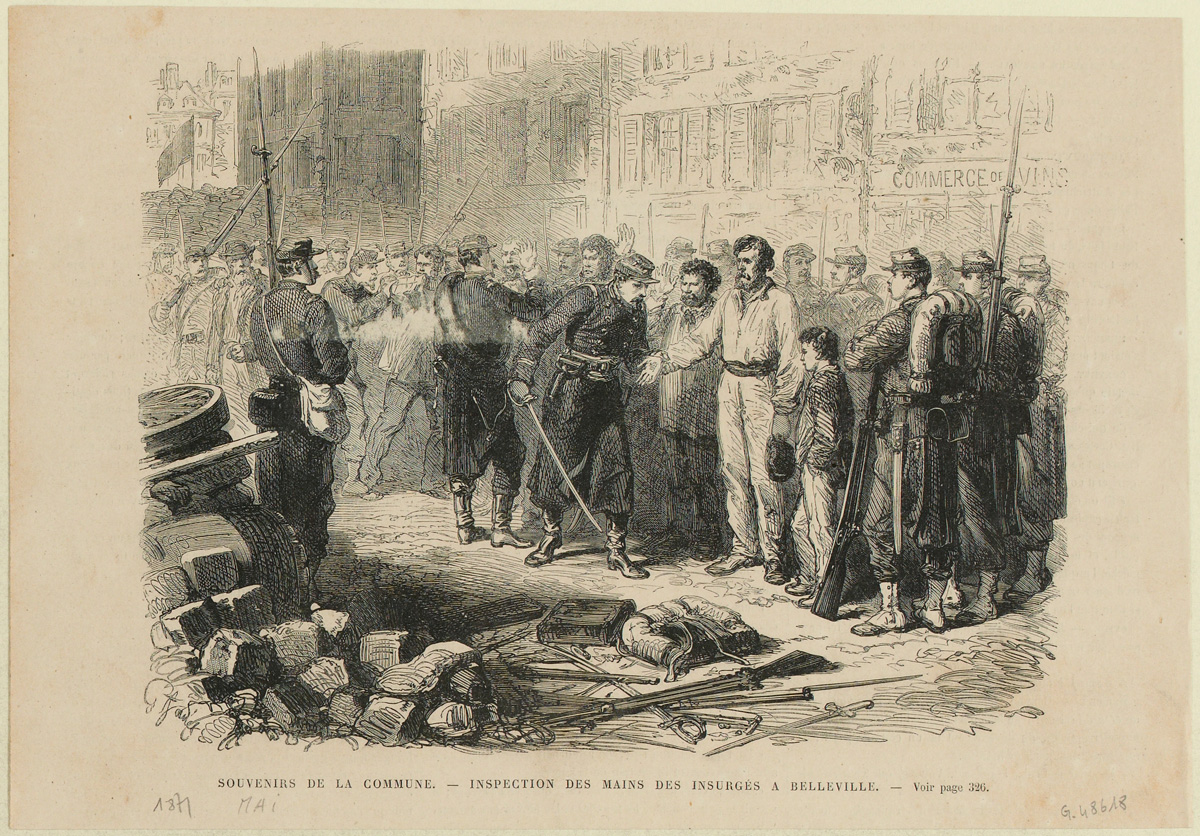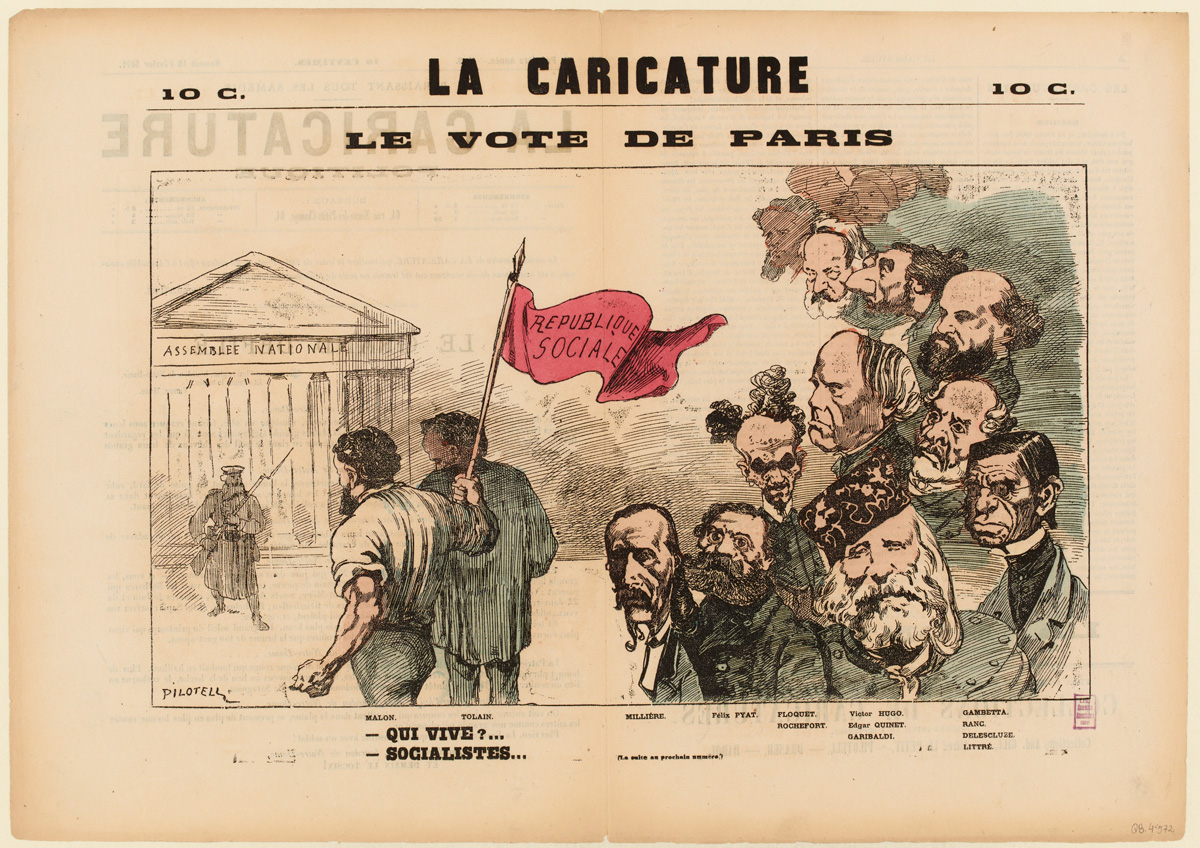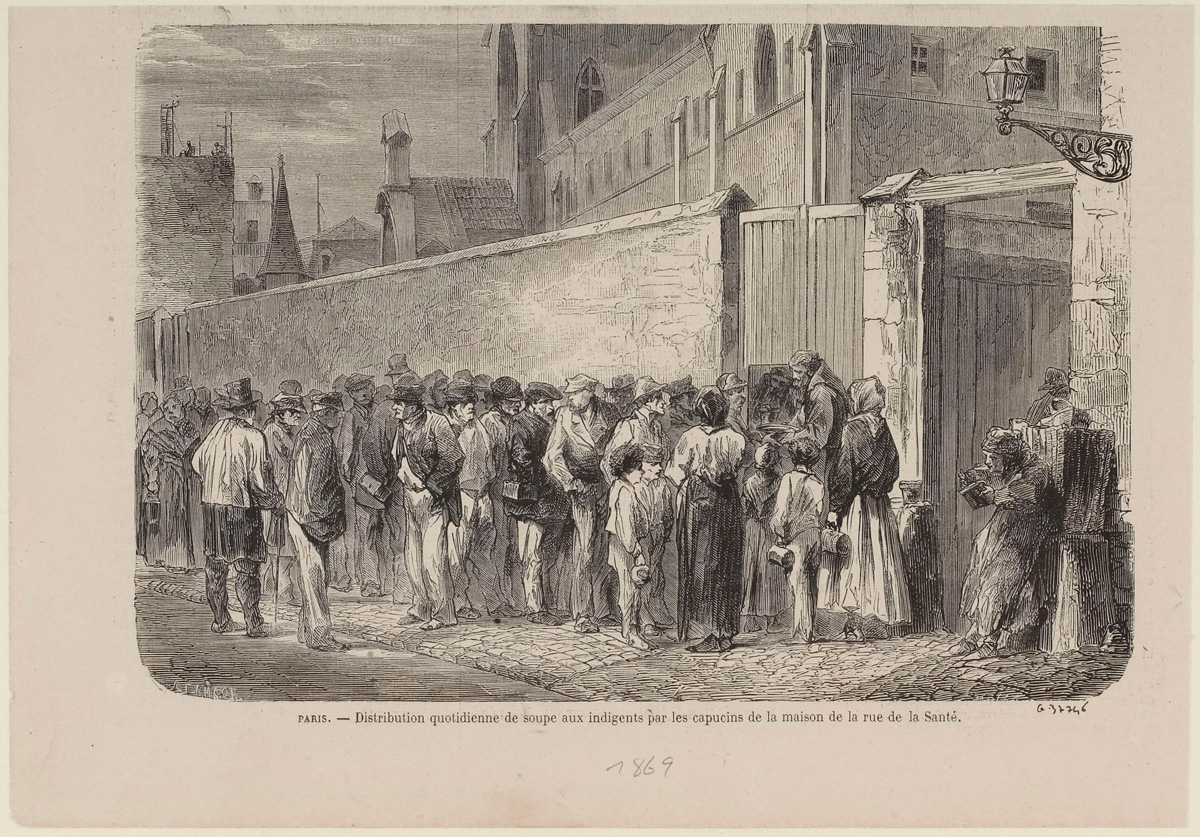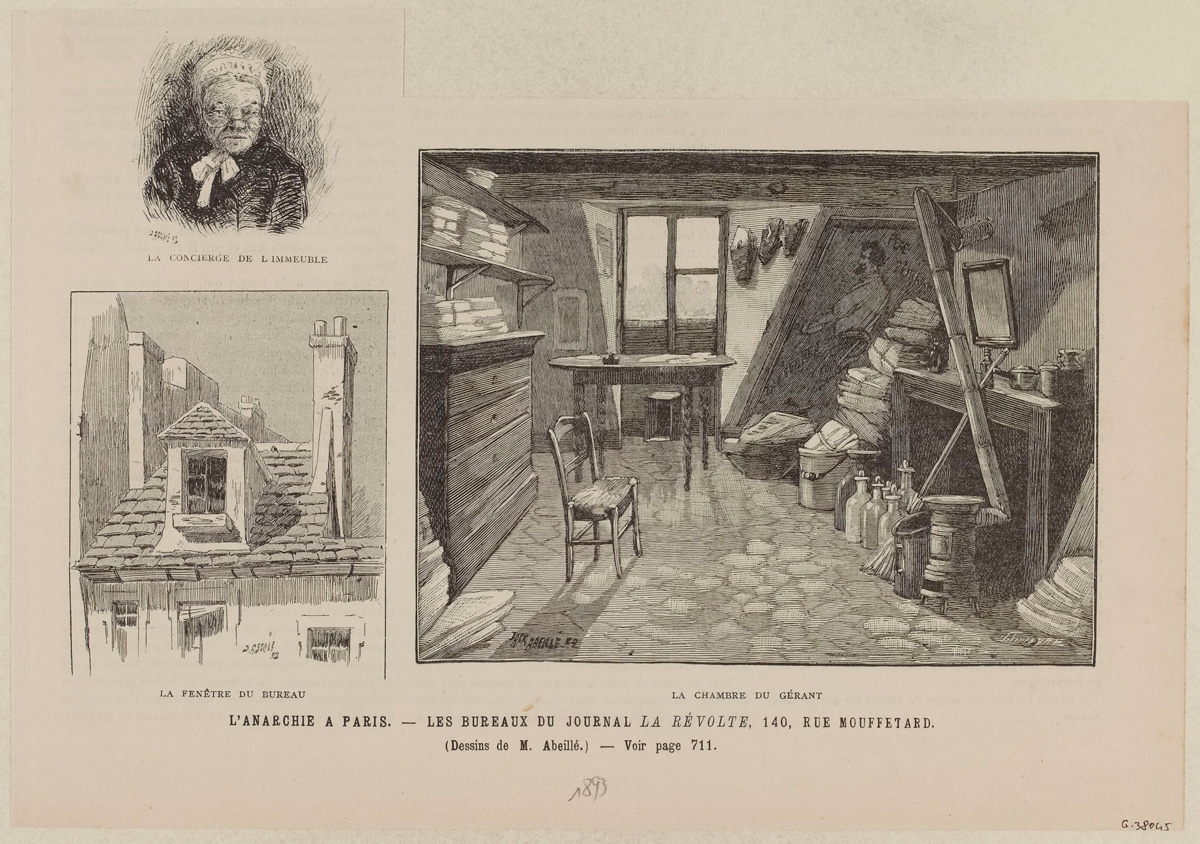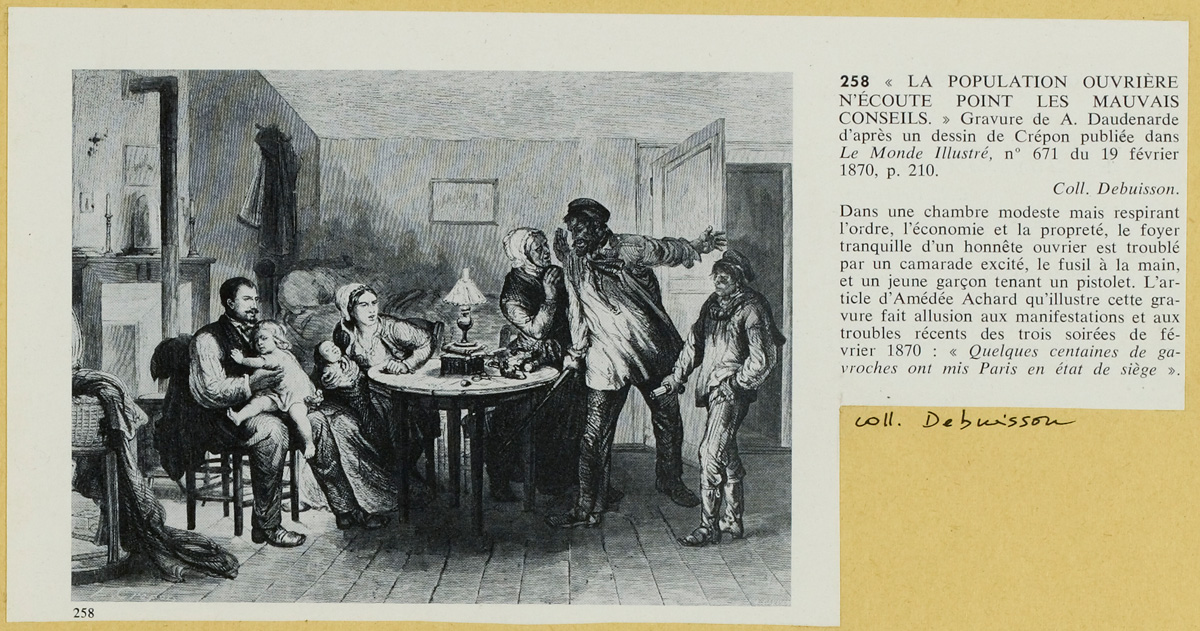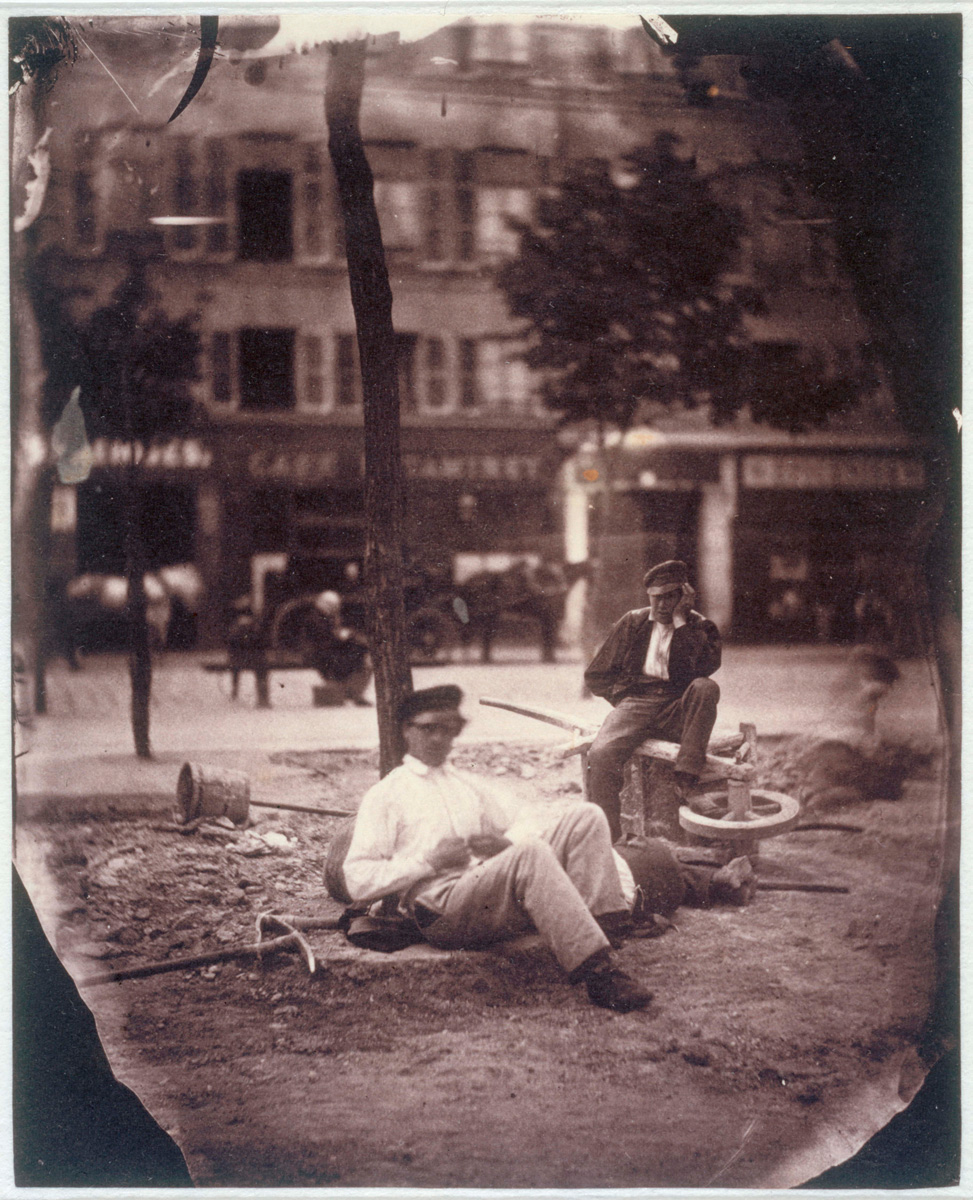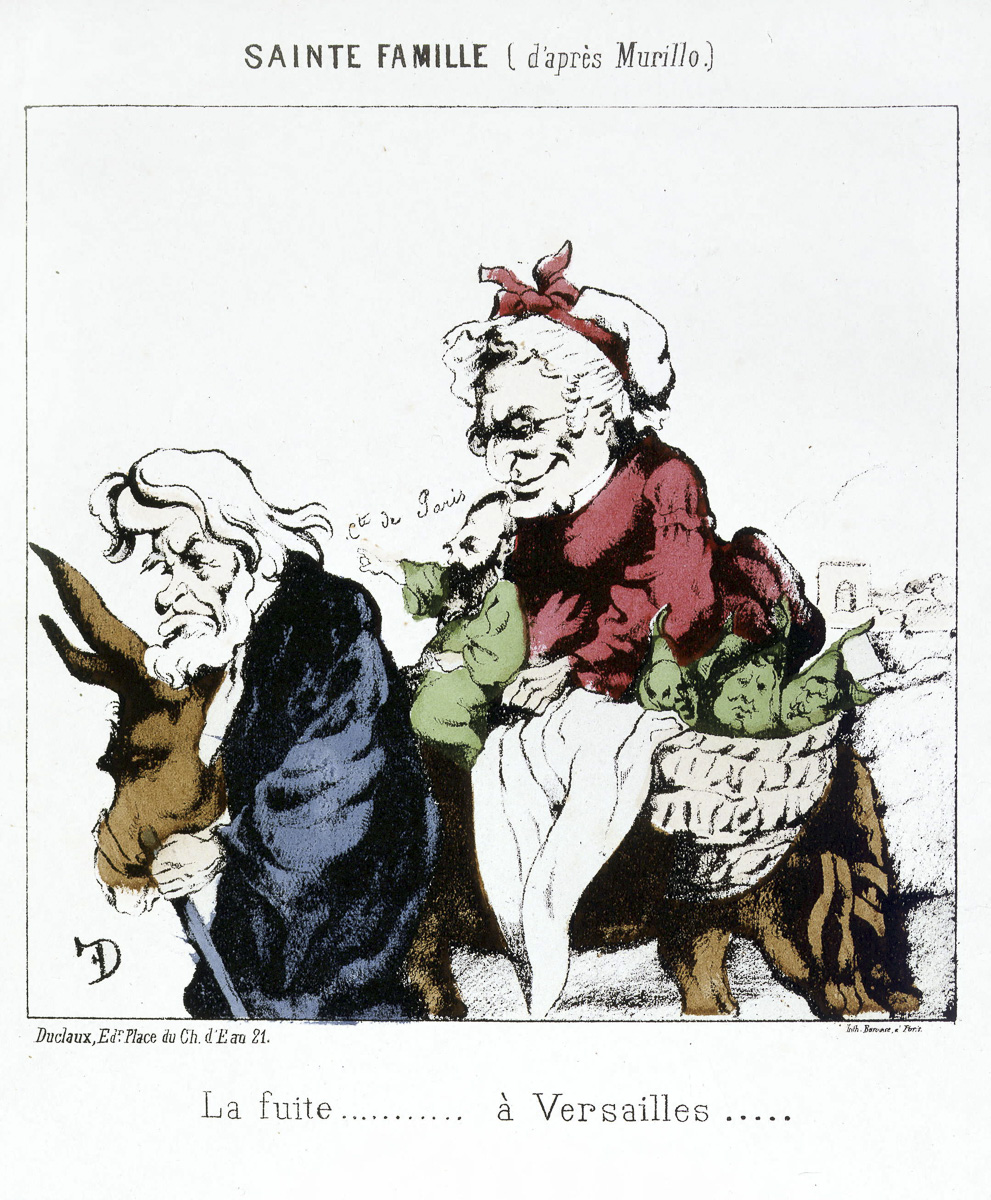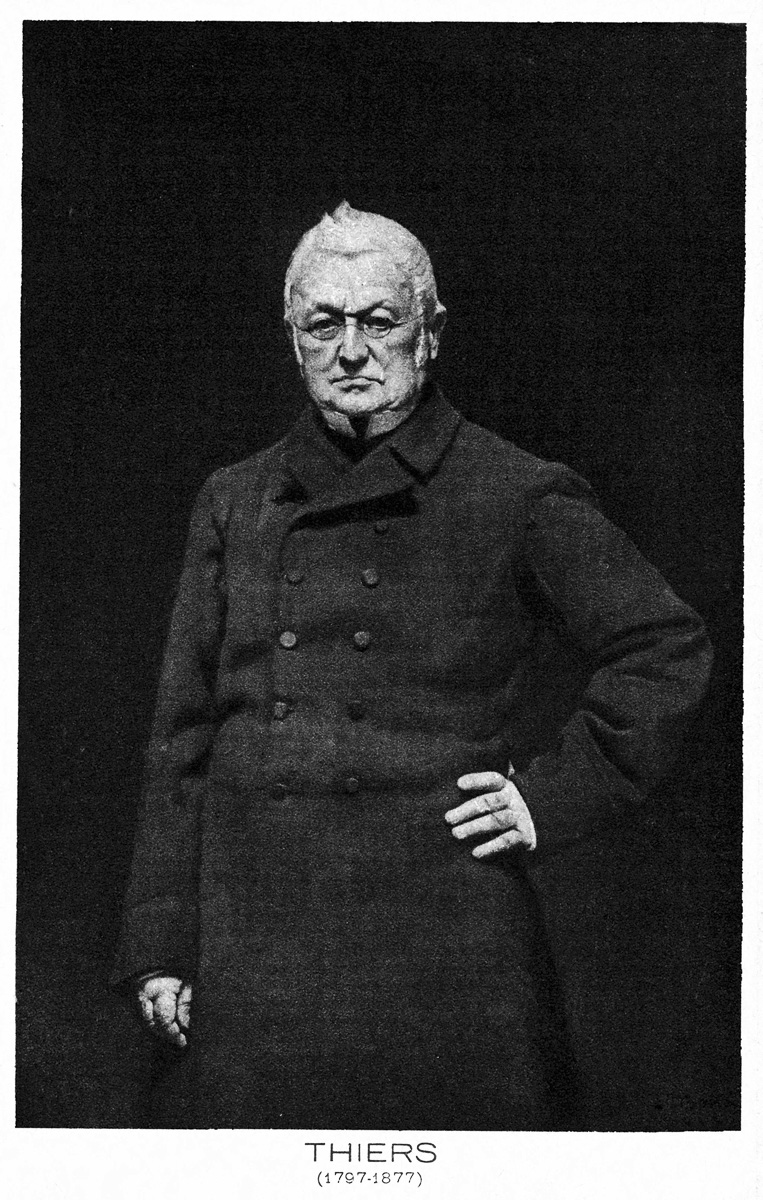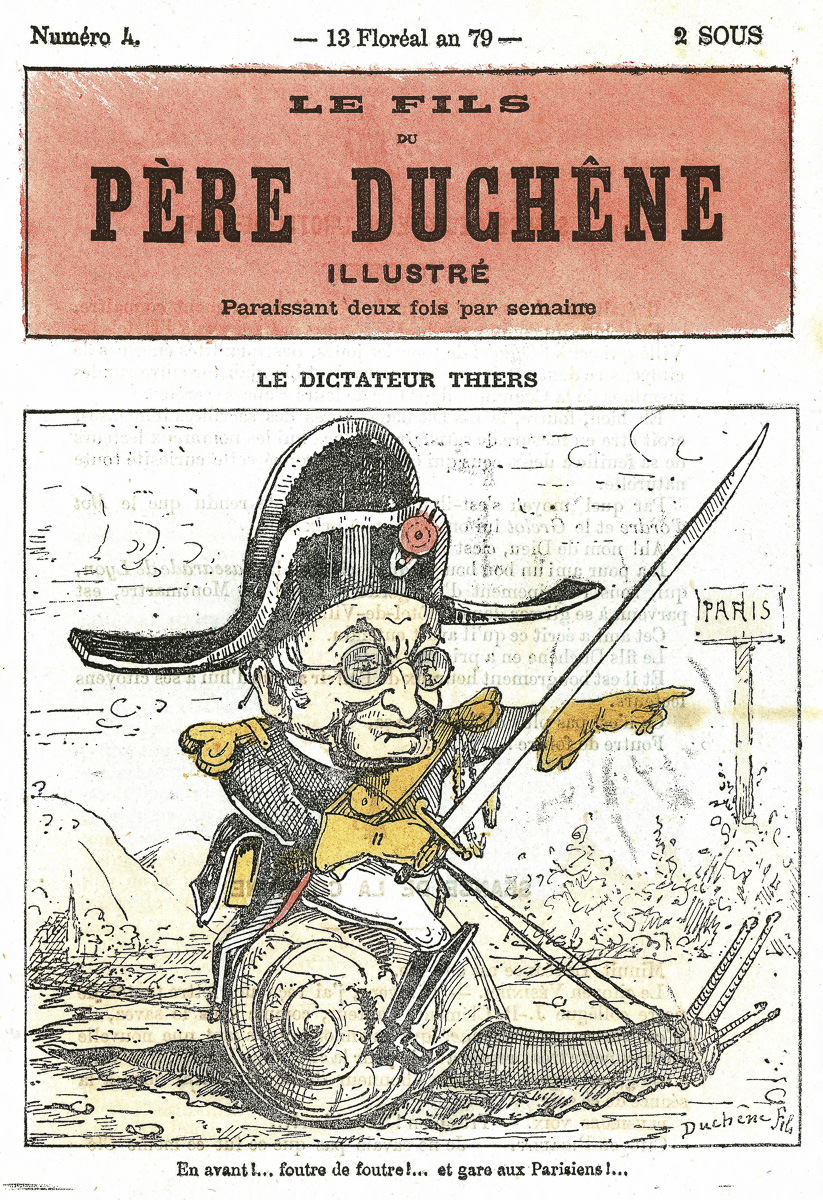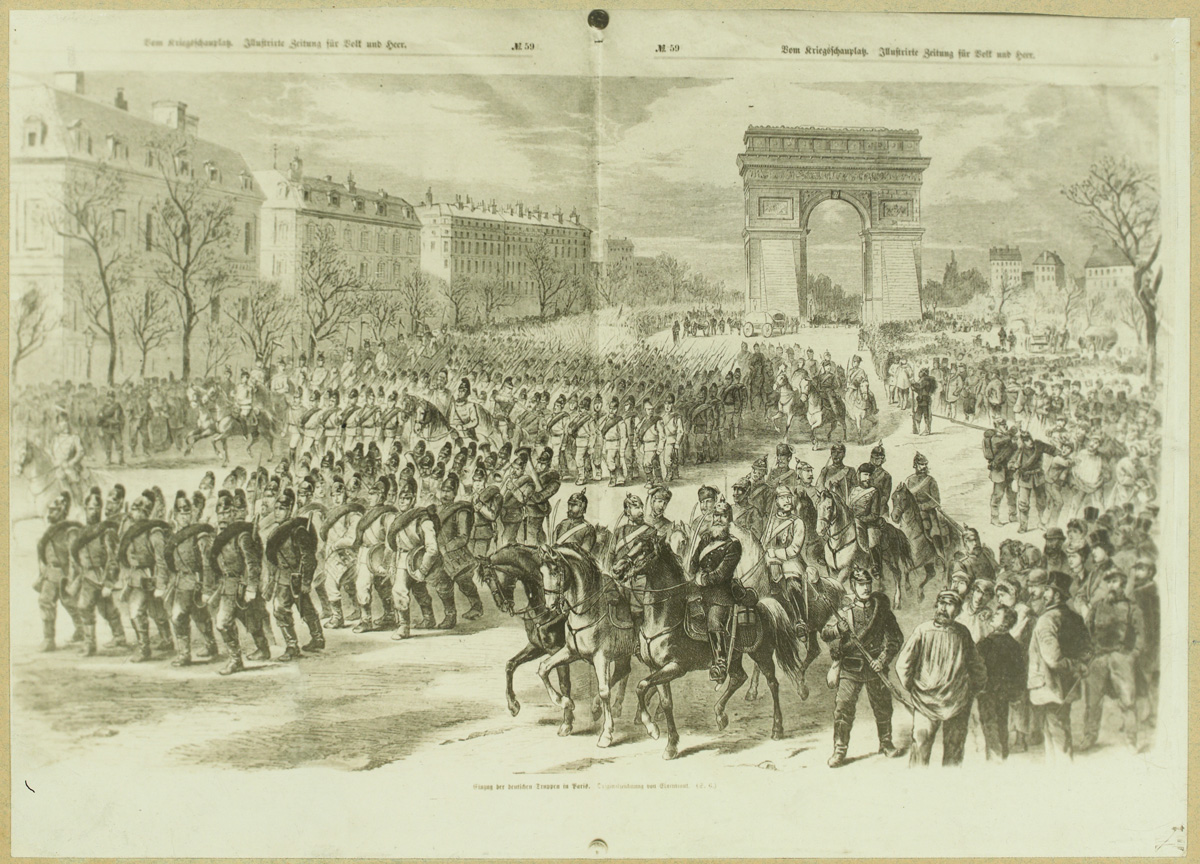Les 150 ans de la Commune : l'origine (1/5)
Série
Mise à jour le 11/03/2021

Sommaire
Le 18 mars 1871, les Parisiens se rebellent contre le gouvernement. C'est le début de la Commune qui durera 72 jours. Un épisode historique qui a marqué les esprits. 150 ans après, la Ville de Paris a décidé de commémorer cet événement avec diverses manifestions. A travers une série de cinq articles, Paris.fr vous propose de revenir sur ce moment majeur de la (longue) vie de la capitale. Premier volet : les causes du soulèvement.
C’était il y
a 150 ans ! Le 18 mars 1871 débutait la Commune de Paris. Un événement qui finira par « la semaine sanglante » du 21 au 28 mai où
environ 20 000 communards furent tués par les Versaillais. Un court moment de l’histoire qui marqua et marque
encore les esprits tant en France qu’à l’étranger.
Une parenthèse durant
laquelle émergèrent cependant des droits et concepts novateurs : l’enseignement laïc et
obligatoire, la séparation des Eglises et de l’Etat, l’ébauche de l’égalité
professionnelle hommes-femmes, le divorce par consentement mutuel, etc.
La Ville de
Paris a décidé de commémorer ce moment
important de son histoire et du pays via de nombreux événements
très divers (conférences, expositions, inaugurations de plaques, etc.).
Dans ce
cadre, Paris.fr vous propose une série d’articles pour mieux comprendre
l’histoire de la Commune : son œuvre, les femmes et les hommes qui en furent les
acteurs, ses lieux symboliques…
Mais, il faut commencer… par le commencement
et comprendre les origines de l’insurrection parisienne.
Les origines immédiates
C’est d’abord la désastreuse guerre mal préparée contre la
Prusse qui a mis le feu aux poudres. L’Empereur Napoléon III, encerclé,
capitule à Sedan le 2 septembre 1870. Dès le 4 septembre, à Paris, la
République est proclamée et un gouvernement de la Défense nationale est formé, composé de républicains modérés (Jules Favre, Jules Ferry), voire de conservateurs (le général Trochu). Ce gouvernement promet de
continuer la lutte malgré le siège de l’armée prussienne que subit Paris à compter du 19 septembre.
Un siège de plus en plus difficile, la population
parisienne souffrant énormément de la
faim. Et les esprits s’échauffent face aux échecs militaires successifs pour
tenter de désenclaver Paris. Après une énième
tentative avortée en direction du Bourget, le 28 octobre, faute d’avoir accepté d’envoyer des renforts, Paris connaît une journée
révolutionnaire le 31 octobre 1870 avec une première tentative d’instituer une
Commune.
Le ton monte encore davantage en janvier 1871 quand les Parisiens
apprennent que, discrètement, depuis des semaines, le gouvernement de la Défense nationale a engagé des pourparlers avec Otto von Bismarck, le chancelier allemand, pour
parvenir à un cessez-le feu.
Et malgré un nouveau soulèvement populaire
parisien le 22 janvier 1871 - où la troupe
tire sur la foule dans le secteur de Belleville - visant à empêcher le
gouvernement de capituler, Jules Favre signe le 28 janvier 1871 un armistice avec
Bismarck. L’accord prévoit l’élection puis la convocation d’une assemblée
nationale qui devra décider si elle accepte une paix définitive.
Une assemblée majoritairement monarchiste
Cette élection a
lieu à la hâte le 8 février 1871. Elle se déroule au suffrage universel… exclusivement
masculin toutefois. De plus, elle est tronquée car 500 000 soldats sont
prisonniers des Allemands ou dans l'incapacité de voter. Et dans les 43
départements occupés par les Allemands, les Français ne peuvent pas non plus
voter. Résultat, sur les 638 députés élus, près de 400 sont de tendance
monarchiste, un peu plus de 200 appartiennent aux différentes familles des républicains et 30 sont
bonapartistes.
Paris se singularise une fois encore en élisant 37
républicains sur un total de 43 députés. Parmi les élus parisiens, on trouve
Louis Blanc, Georges Clemenceau, Victor Hugo… Le fossé va donc grandissant
entre Paris et la province. La Capitale estime s’être bien défendue et ne pas
avoir perdu contre les Prussiens/Allemands. Pour la ville, l’armistice est insupportable. A l’inverse, la province veut majoritairement la paix.
Les causes plus profondes
Paris est donc en décalage avec le
reste du pays encore très rural et sensible aux opinions des notables locaux. Même s'il y a des embryons de "Communes" à Lyon, Marseille ou encore Saint-Etienne, elles sont très vite réprimées.
La
sociologie de Paris est très particulière pour l’époque. La capitale
est déjà une très grande ville de 1,8 million d’habitants. 57 % de ces habitants
vivent du travail industriel et 12% d’une activité commerciale. Depuis la
révolution de 1848, la ville est régulièrement le théâtre de grèves, droit obtenu en 1864, et de révoltes. La
classe ouvrière est en pleine prise de conscience, d’autant plus que sa
situation matérielle est désastreuse. Le baron Haussmann, proche de
Napoléon III, note ainsi que plus de la moitié des Parisiens vivent « dans
une pauvreté voisine de l’indigence ».
En outre, les transformations urbanistiques, notamment celles du
Second Empire, ont quasi mis fin à la mixité sociale au sein de Paris. Les
classes populaires (ouvriers et
artisans) sont désormais très majoritairement concentrées dans le nord et l’est de la capitale (10e,
11e, 12e, 13e, 18e, 19e
et 20e arrondissements), ce qui facilite leur organisation et
encourage la propagation des idées républicaines, socialistes ou anarchistes.
Dans ce contexte, il
convient de mentionner la situation particulière des femmes. Elles représentent
33 % de la population active parisienne et gagnent moitié moins que les
hommes. Dans les ateliers, elles sont très souvent bafouées par leurs patrons
et chefs d’équipe. Et leur condition est
également difficile au domicile… Dès lors, les femmes ouvrières ressentent une
immense volonté d’expression démocratique. D’où leur engagement précoce contre
les Versaillais et en faveur de la Commune.
Le déclenchement
Paris est donc une
poudrière avec une population politisée, organisée, armée (les 180 000 membres
de la Garde nationale créée pour faire face à l’ennemi prussien) .Or, malgré
tout, le nouveau gouvernement à la tête
du pays va multiplier les provocations…
Depuis Bordeaux où
elle siège, Paris étant toujours assiégée, la nouvelle assemblée sortie du scrutin du 8 février 1871 a confié le pouvoir exécutif à Adolphe
Thiers -premier président dans les faits, sinon légitimement, de la IIIe
République - connu pour son conservatisme et sa volonté farouche de soumettre
Paris la rebelle. Affront suprême pour les Parisiens : les Allemands
obtiennent de Thiers le droit de défiler sur les Champs Élysées le 1er
mars 1871, Thiers ayant signé un traité préliminaire de paix avec le chancelier
Bismarck.
Puis, nouvelle
provocation, au lieu de réintégrer Paris jugée trop « rouge », l’assemblée
quitte Bordeaux pour s’installer à Versailles… la ville royale !
D’autres décisions
de Thiers enveniment encore la situation : la solde des membres de la
Garde nationale est supprimée, ce qui prive de revenus de très nombreux Parisiens et leurs familles ; le moratoire sur le paiement des loyers,
institué au début de la guerre, est aussi levé ; des généraux d’obédience
bonapartiste sont nommés a des postes clés, notamment à la tête de la Garde nationale…
L'affaire des canons
Le dernier
élément déclencheur est « l’affaire des canons ». Thiers décide le
16 mars 1871 de désarmer la ville afin de la purger de « tous les rouges ».
227 canons ont été retirés par la Garde nationale des Champs Élysées avant le défilé des Prussiens et ont été
entreposés sur les collines de Montmartre et Belleville.
Adolphe Thiers envoie
4000 soldats chercher les canons dans la nuit du 17 au 18 mars. Alors que les soldats
attendent les chevaux pour descendre les canons, ils se trouvent entourés par la
foule – dont beaucoup de femmes menées par Louise Michel – et les gardes nationaux.
Les soldats pactisent alors avec les insurgés parisiens. Et malgré l’intervention
de Clemenceau, maire du 18e arrondissement, le
général Lecomte, qui avait ordonné de tirer sur la foule, et le général
Thomas, à qui l’on reproche d’avoir participé à la répression de juin 1848, sont
fusillés. Un peu partout dans différents quartiers, des barricades
s’élèvent et de nombreux soldats fraternisent avec les Parisiens.
Thiers, de peur d’être
fait prisonnier, décide alors de quitter la capitale pour Versailles. Environ
100 000 Parisiens le suivront, ainsi que la majorité des fonctionnaires. C’est
le vrai début de la Commune de 72 jours…
Le comité central de
la Garde nationale siège, lui, à l’Hôtel de Ville et décide d’organiser des élections
dans la capitale. Il est soutenu par de nombreux clubs. Les élections ont
lieu le 26 mars 1871. On compte environ 230 000 votants sur les 485 000 inscrits
(soit environ 52 % d’abstention, notamment du fait du départ de nombreux Parisiens).
Dès le 28 mars, le nouveau
Conseil vote la Commune en référence à la Commune insurrectionnelle qui mis fin
à la monarchie le 10 août 1792.
Une majorité et une minorité
Sur les 92 membres élus
du Conseil municipal, environ une vingtaine appartenant au "parti des
Maires" (modérés) refusent de siéger. lls ont été essentiellement élus par les
habitants du centre et de l’ouest parisien. Les 70 restants appartiennent à des
tendances républicaines et socialistes très diverses : les révolutionnaires (notamment les blanquistes) et les jacobins qui
formeront une « majorité » ; et du côté de la « minorité »,
des militants ouvriers de tendance marxiste ou anarchiste qui veulent davantage
mettre l’accent sur les questions sociales.
On retrouve aussi quelques indépendants, tel le peintre Gustave Courbet. Parmi les élus, 33
sont des artisans et petits commerçants, 24 sont issus de professions libérales
ou intellectuelles (journalistes, architectes, médecins, etc.) et 6 sont ouvriers.
Si « majorité »
et « minorité » vont vite s’opposer sur le mode de gouvernement
notamment, tous seront unis face à l’offensive versaillaise, qui va très vite se
préciser…
Pour en savoir plus
Le site des Archives de Paris commémore depuis l'an dernier les 150 ans de la guerre franco-prussienne et cette année l'anniversaire de la Commune. Retrouvez les nombreux documents et publications sur le site.
Votre avis nous intéresse !
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).