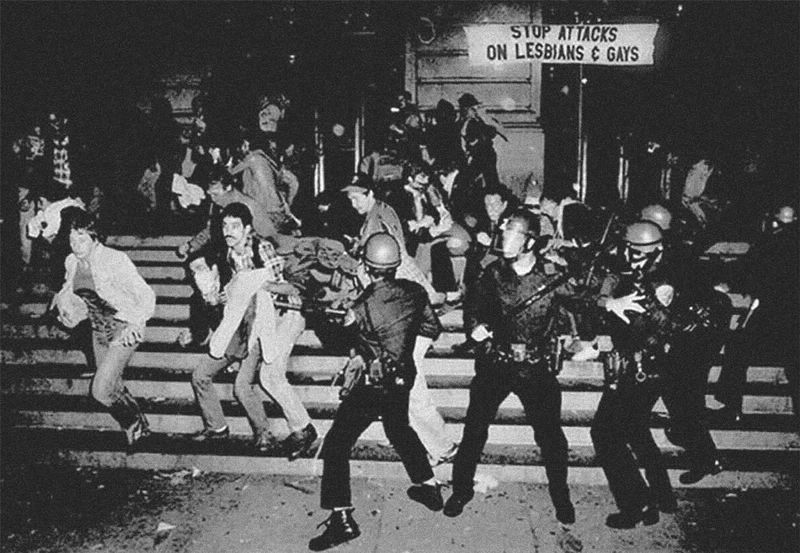Un parcours mémoriel dans les rues portant le nom de personnalités LGBTQIA+
Le saviez-vous ?
Mise à jour le 21/06/2023

Sommaire
Paris, ville phare de l’inclusion et de la diversité, célèbre, avec la dénomination de rues, places et squares et l'apposition de plaques commémoratives, des personnalités engagées dans la lutte contre les discriminations et les diverses formes de LGBTphobies.
Engagée dans
la promotion d’une politique locale pour les personnes LGBTQIA+, Paris met aussi à l'honneur ceux qui se battent au quotidien pour défendre leurs droits
fondamentaux. Ainsi, depuis plusieurs années, le Conseil de Paris décide de donner le nom de personnalités connues et moins connues engagées dans la lutte contre les discriminations à des rues et places dans
différents quartiers, à commencer par le 4e, refuge pour la communauté LGBTQIA+.
Depuis 2019, 25 personnes ont ainsi été honorées, à commencer par Pierre
Seel, déporté durant la Seconde Guerre mondiale à cause de son homosexualité, le dessinateur américain Keith Haring, la
psychiatre engagée Madeleine Pelletier, l’essayiste Pierre Herbart, l’autrice féministe Tereska Torres, la
peintre allemande Catherine Breslau et sa compagne Madeleine Zillhardt
ou encore le metteur en scène Patrice Chéreau ou Cleews Vellay, ancien
président d’Act Up-Paris qui a sa promenade dans le 10e, mais aussi…
Une place pour Harvey Milk (Paris Centre)
Cette place est située à l'intersection de la rue des Archives et de
la rue de la Verrerie . Située dans
le quartier du Marais, elle en constitue
l'un des carrefours les plus fréquentés.
Homme politique et activiste américain gay, Harvey Milk (1930-1978) est devenu en 1977 l’un des premiers
élus ouvertement homosexuel de l’histoire des États-Unis. Durant ses onze mois
aux affaires, cette figure du quartier gay du Castro (San Francisco) a soutenu une loi
interdisant les discriminations liées à l’orientation sexuelle.
Il a été assassiné, aux côtés du maire de San Francisco, George Moscone, le 27 novembre
1978. Le verdict à l’encontre de l’assassin, considéré comme trop clément par
la communauté LGBT, mais pas seulement, a provoqué des émeutes dans la nuit du
21 mai 1979, réprimées par la police de San Francisco.
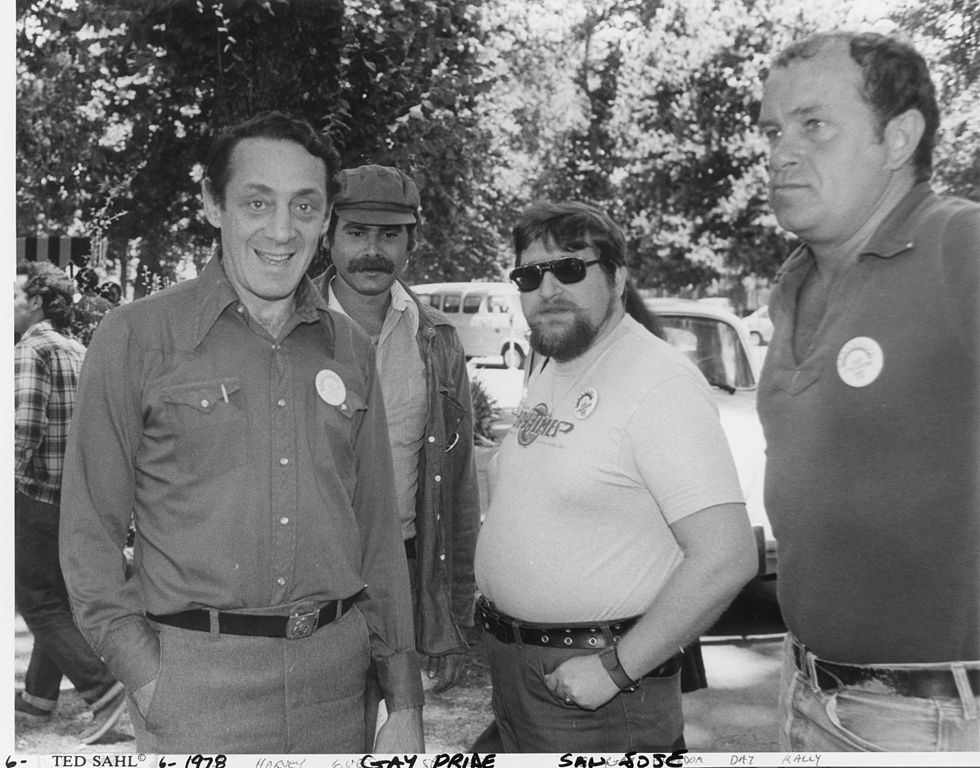
Harvey Milk à la Gay Pride de San Jose en juin 1978
Credit
Ted Sahl
Une plaque pour Gilbert Baker (Paris Centre)
Gilbert Baker
(1951-2017) est le créateur du célèbre « rainbow flag », le drapeau
arc-en-ciel, emblème de la communauté LGBTQIA+. Cet artiste et activiste
américain l’a dessiné en 1978, en y incluant les différentes couleurs
reflétant la diversité de ses membres. À l’origine, il avait choisi huit
teintes (du rose vif au violet), représentant, dans l’ordre : le sexe, la
vie, la guérison, la lumière du soleil, l’art, la sérénité et l’esprit.
Le 19 juin 2019, la Ville de Paris a dévoilé la plaque
commémorative en sa mémoire, sur la nouvelle place des Émeutes-de-Stonewall, dans le quartier du Marais. Cette place rend
elle-même hommage à un événement phare du mouvement pour la conquête des
droits des gays. Les émeutes ont commencé le 28 juin 1969 au matin, après
une descente de la police de New York dans un bar gay de Greenwich Village, le
Stonewall Inn. L’incident a provoqué des affrontements et a marqué la réelle
éclosion du militantisme LGBTQIA+. De nombreuses associations défendant les droits
des homosexuels ont été créées à travers tout le pays. Un an plus tard, la
première gay pride était organisée dans les villes de New York,
Los Angeles, San Francisco et Chicago.
Une plaque pour Raúl Damonte Botana, dit Copi (18e)
Romancier, dramaturge et
dessinateur argentin, Copi (1939-1987) avait fait de Paris sa ville d’adoption
en 1963, et notamment le 18e arrondissement où il a désormais sa plaque
au 10, rue Cauchois.
C’est comme dessinateur qu’il travaille au Nouvel Observateur puis
pour Hara-Kiri et Charlie Hebdo où son personnage de dame assise pleine d’a
priori, monologue ou dialogue avec un volatile informe.
Il
se met ensuite à l’écriture de pièces de théâtre, dont L’Homosexuel ou la
Difficulté de s’exprimer (1967) où Copi joue lui-même un travesti
délirant. C’est encore lui qui, en tant qu’acteur, fait une apparition en
travesti décalé dans le clip publicitaire « C’est fou ! » pour Perrier !
Compagnon de la figure de proue du mouvement gay Guy
Hocquenghem, il suit ce dernier à Libération où ils forment à partir de 1973 un
petit groupe d’homosexuels au sein de la rédaction et militent pour une meilleure
visibilité gay et lesbienne.

Copi. Paris, avril 1970
Credit
Anne Salaün / Roger-Viollet
Une place pour Ovida Delect (Paris Centre)
À l’intersection entre la rue des Blancs-Manteaux et la rue des Archives (4e),
la place Ovida-Delect rend hommage à l’écrivaine et poétesse française transgenre
morte en 1996.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, avec des amis, elle a fondé un groupe de résistants et a infiltré une
organisation de jeunes collaborateurs en se faisant passer pour l’un d’eux. Son
action a porté de sévères coups à cette structure. En 1944, elle a été
arrêtée par la Gestapo et torturée plusieurs jours avant d’être déportée au
camp de Neuengamme, en Allemagne, où elle resta prisonnière jusqu’à la fin de
la guerre.
Ovida Delect a écrit de nombreux livres et poèmes sous son nom de
femme, mais n’a officiellement changé d’identité que dans les années 1980.

Ovida Delect dans le documentaire "Appelez-moi Madame"
Credit
Françoise Romand
Une promenade pour Coccinelle (18e)
Coccinelle (1931-2006) est une
danseuse, chanteuse et actrice transgenre. Elle débute dans le monde du
spectacle en 1953 chez Madame Arthur puis au Carrousel à Paris. Défendue par
l’avocat Robert Badinter, Coccinelle
devient à l’état civil Jacqueline
Charlotte Dufresnoy en 1959. Première célébrité française à
officiellement changer de sexe, elle est ainsi une égérie transgenre dans les
années 1950. Dans les années 1960, elle joue dans plusieurs films et enregistre des chansons, telles que Chercher la femme.
À
partir de 1970, elle entame une série de tournées qui la conduira autour
du monde. C’est seulement en 1986 qu’elle revient
à Paris, chez Madame Arthur, où elle avait débuté quarante ans
plus tôt… à proximité de la longue promenade qui porte désormais son nom.

Coccinelle. Paris, Club Saint-Hilaire, 1963.
Credit
Noa / Roger-Viollet
Un jardin suspendu pour Françoise Mallet-Joris (13e)
C’est un balcon verdoyant au-dessus de la rue
du Chevaleret, plus précisément au 70-76, avenue d’Ivry, qui porte le nom de l’écrivaine.
Née
Françoise Lilar en 1930 en Belgique, elle publie à 16 ans sa première
œuvre, Poème du dimanche. Elle ne
peut publier sous son nom, à 19 ans, un roman lesbien Le Rempart des
Béguines et se choisit alors le pseudonyme de Mallet. En 1950, elle y
ajoute Joris pour garder une consonance belge.
Le Rempart des Béguines évoque une histoire
d’amour entre une jeune fille et la maîtresse de son père. L’ouvrage est
adapté au cinéma en 1972.
Elle a également été parolière et
compagne de la chanteuse Marie-Paule
Belle, pour
qui elle a écrit la chanson La Parisienne. Ensemble, elles font les frais d’une
violence homophobe que l’on retrouve dans les paroles de Celles qui aiment
elles.
Membre du comité du Prix Femina de 1969 à 1971, elle est élue à l’unanimité en novembre 1971 à
l’Académie Goncourt où elle siège jusqu’à sa
démission en 2011, pour des raisons de santé. De 1993 à sa mort
en 2016, Françoise Mallet-Joris est membre de l’Académie
royale de langue et de littérature françaises de Belgique.

Françoise Mallet-Joris (née Françoise Lilar, 1930-2016). Décembre 1985.
Credit
Roger-Viollet / Roger-Viollet
D’autres plaques et noms de rues sont en cours d’instruction ou en attente d’inauguration, comme le jardin Valentine-Schlegel, en hommage à la sculptrice française dans le 14e, ou la Médiathèque James Baldwin dans le 19e.
En outre, le 17 mai 2024 devrait été inauguré un monument dédié à la déportation homosexuelle et plus largement aux discriminations LGBTQIA+ dans l’Histoire, en lien avec l’association Les Oublié-e-s de la Mémoire. Ce geste artistique et mémoriel prendra place dans le jardin des Champs-Élysées, allée Marcel Proust.
Votre avis nous intéresse !
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).
Si vous avez une question, souhaitez un suivi ou avez besoin d'assistance : contactez la Ville ici.